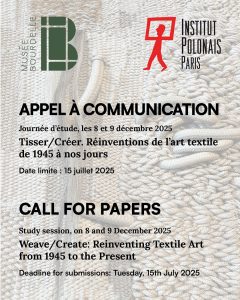 Organisée par le musée Bourdelle et l’Institut polonais de Paris les 8 et 9 décembre 2025 à l’occasion de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence » présentée au musée Bourdelle (20 novembre 2025 – 12 avril 2026), cette journée d’étude a pour objectif de revenir sur l’émergence, à partir de 1945, d’une scène artistique européenne et internationale qui choisit de mettre en forme le matériau textile.
Organisée par le musée Bourdelle et l’Institut polonais de Paris les 8 et 9 décembre 2025 à l’occasion de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence » présentée au musée Bourdelle (20 novembre 2025 – 12 avril 2026), cette journée d’étude a pour objectif de revenir sur l’émergence, à partir de 1945, d’une scène artistique européenne et internationale qui choisit de mettre en forme le matériau textile.
Appel à communication :
« Je considère la fibre comme l’élément fondateur qui construit le monde organique de notre planète, comme le plus grand mystère de notre environnement. C’est à partir de la fibre que sont construits tous les organismes vivants, le tissu des plantes, des feuilles et notre propre tissu. »[1]
Au tout début des années 1960, l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz (1930 – 2017) délaisse le plan du mur pour concevoir des œuvres textiles suspendues dans l’espace, appelées Abakans, qui subvertissent le cadre des catégories artistiques. Ses expérimentations en fibres naturelles (chanvre, crin de cheval, lin, sisal) coïncident avec l’avènement des mouvements artistiques tels que le Fiber Art aux Etats-Unis et la Nouvelle tapisserie en Europe. D’autres artistes s’engagent dans une transition similaire, passant d’une surface bidimensionnelle à un objet tissé, interrogeant la dimension immersive du textile, à l’instar d’Olga de Amaral, Jagoda Buić, Ritzi Jacobi, Ana Lupas, Wojciech Sadley, Sheila Hicks ou Harmony Hammond… Quelles sont les raisons – économiques, politiques, sociales, genrées – qui encouragent les artistes, et notamment les femmes, à s’emparer ainsi de ce matériau à partir des années 1960-1970 ? Peut-on d’ailleurs parler uniquement d’un art textile lorsque le tissu est comprimé, moulé ou recouvert de plâtre ? Les frontières entre tissage et modelage deviennent poreuses, et tout le défi réside dans la manière de « sculpter » les formes molles.
Les réflexions des artistes du minimalisme américain (Donald Judd, Kenneth Noland, Carl Andre) entrent également en résonance avec les propositions de ces artistes, femmes ou hommes, du textile. Dès la fin des années 1960, leurs créations deviennent à leur tour des « objets spécifiques » perçus dans un espace donné et intrinsèquement liés à leurs environnements. Qu’il s’agisse des Abakans ou même des Pénétrables de Jesús-Rafael Soto, ces œuvres proposent des formes pionnières d’installation et deviennent site-specific, constamment remodelées en fonction de leurs contextes de création. A ce titre, comment le matériau textile, une fois séparé du mur, propose-t-il une nouvelle manière d’investir l’espace, puisqu’elle semble se recomposer à l’infini ?
Par ces recompositions successives, l’œuvre textile décrit un processus évolutif comparable à celui d’une croissance organique. Ce caractère biologique est très présent dans le travail d’Abakanowicz, qui interroge l’analogie féconde entre tissu vivant et tissu inerte. La qualité texturée de ses œuvres suppose une fascination haptique, qui appelle un contact, un toucher. Abakanowicz n’a jamais cessé d’affirmer une relation d’identification entre son travail et sa propre peau. Elle n’est d’ailleurs pas la seule artiste à utiliser des matériaux mous pour représenter un corps fragmenté, où le textile remplace le fluide, comme c’est le cas chez Eva Hesse, Lynda Benglis ou Louise Bourgeois. Quelle place est donnée au corps dans cette utilisation du matériau textile, notamment chez les artistes femmes ?
Aujourd’hui, les artistes contemporains développent et élargissent ces liens entre le corps et le tissu dans leurs pratiques variées : broderies, patchwork, couture deviennent des porteurs de messages sociaux, politiques et féministes, surtout après la pandémie de Covid-19. Le tissu est dès lors utilisé comme un matériau devenu le support d’activités collectives, thérapeutiques ou engagées.
Non cantonnées à un champ de recherche spécifique, les propositions de communications pourront s’appuyer sur les thématiques suivantes, sans s’y limiter :
- Approches théoriques : historiographie des mouvements de l’art textile bi- et tridimensionnel (Fiber Art, Textile Art, Wall Hangings…) ; théories de l’art textile et approches interdisciplinaires (histoire de l’art, psychologie, philosophie, sociologie…) ; rôle et origine des traditions populaires, pratiques artisanales et sensibilités locales dans le développement de l’art textile ; métaphores, symboliques et mythologies associées au textile.
- Approches matérielles et techniques: explorations matérielles du textile dans la création artistique après 1945 ; aspects techniques (travail de tissage, travail de broderie, de couture…) ; nouvel intérêt pour le cordage, le tissu, les fibres naturelles ; questions liées à la conservation et restauration de cet art textile.
- Dans l’atelier : caractère collectif du travail textile à travers l’ouverture de nouvelles formations, de cours particuliers dans les écoles d’art et les manufactures ; place des assistants tisserands et leur rôle déterminant dans la création textile monumentale.
- Sculptures textiles : études du matériau et de ses possibilités plastiques, de la souplesse, de l’élasticité des matériaux ; interrogations autour du matériau-peau, de la mollesse en sculpture ; réflexions autour de l’échelle et de la sculpture-textile monumentale.
- Régionalisme / universalisme du textile, pour une histoire mondiale de l’art textile: dépasser la lecture moderniste de l’abstraction textile afin d’aborder le contexte politique et social de ces créations (Europe de l’Est, Amérique du Sud, etc).
- Questions de genre : l’affranchissement du médium et l’affranchissement des artistes femmes ; la place du matériau textile dans l’historiographie des artistes femmes.
Comité scientifique et organisation :
- Ophélie Ferlier Bouat, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Bourdelle
- Jérôme Godeau, commissaire d’exposition, historien de l’art, musée Bourdelle
- Lili Davenas, conservatrice peintures et arts graphiques, musée Bourdelle
- Natalia Barbarska, responsable de projets, Institut polonais de Paris
Les propositions de communication contenant un titre, un résumé (300 mots maximum) et une notice biographique (150 mots max) sont attendues aux adresses suivantes :
natalia.barbarska@instytutpolski.pl
Date limite : 15 juillet 2025
Chaque communication durera 20 minutes – hors table-ronde – et pourra faire l’objet d’une captation filmée.
[1] Propos rapportés, “On Fiber”, Magdalena Abakanowicz, cat. exp., Londres, Tate Modern, 17 nov. 2022 – 21 juin 2023, Londres, Tate Publishing, 2022, p.9. [Notre traduction]

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.