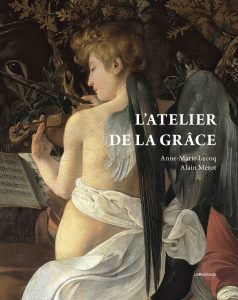 L’Atelier de la grâce
L’Atelier de la grâce
par Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot,
Paris, Editions Le Passage, 20025.
Pages : 504
320 illustrations
Format : 19,7 × 25 cm
ISBN : 978-2-84742-521-5
Faveur divine mystérieusement accordée aux mortels – tel le don du printemps, toujours immérité et toujours renouvelé –, la grâce est douceur, clarté, fluidité, légèreté. Associée à la jeunesse, elle vient animer la beauté, elle est la vie même. Chaque grande époque lui a apporté de nouveaux caractères : fécondité et lumière pour les anciens Grecs, nécessité du lien social et de l’amitié chez les Romains, charité et visions paradisiaques au Moyen Âge.
Fortes de ce triple héritage, la Renaissance puis l’époque moderne, au moins jusqu’au xviiie siècle, ont reconnu dans l’artiste le vecteur par excellence de la grâce. Par le travail que celle-ci opère en lui, il est à même de faire bénéficier son public des effets du don rare dont il est tributaire. Rencontre qui tient du miracle : l’œuvre gracieuse a toujours été difficile à définir, sinon par ce « je ne sais quoi » qui fait tout son charme.
Au cœur de ce livre, qui associe l’histoire de l’art et des théories poétiques et esthétiques à celle des religions et des sociétés, se trouvent donc les artistes et leurs créations. Les étudier sous l’angle de la grâce permet de les voir dans un nouveau jour, d’en distinguer les multiples nuances et implications, de saisir le fil qui, dès les origines, les relie. Autour du groupe antique des trois Grâces et de ses métamorphoses successives, véritable point focal de cette étude, les statues des dieux païens rencontrent les Vierges du Moyen Âge mais aussi telle Vénus de Botticelli, tel ange de Fra Angelico ou du Caravage, tel enfant de Chardin… C’est dire l’ambition, mais aussi la variété d’un ouvrage qui réservera à ses lecteurs plus d’une surprise.
Les auteurs :
Anne-Marie Lecoq, ingénieur de recherches honoraire au Collège de France, où elle a travaillé aux côtés d’André Chastel, puis de Marc Fumaroli, spécialiste de la Renaissance, est l’auteur de plusieurs livres sur des questions d’iconologie : La Peinture dans la peinture (avec P. Georgel), 1987 ; François Ier imaginaire, 1988 ; La Leçon de peinture du duc de Bourgogne, 2003 ; Le Bouclier d’Achille, 2010.
Alain Mérot, professeur émérite d’histoire de l’art moderne à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de la peinture du xviie siècle, a publié notamment les monographies Nicolas Poussin, 1994/2011, et Eustache Le Sueur, 2000 ; une synthèse sur La Peinture française au xviie siècle, 1994 ; et plusieurs essais : Retraites mondaines. Aspects de la décoration intérieures à Paris au xviie siècle, 1990 ; Généalogies du baroque, 2006 ; Du paysage en peinture à l’époque moderne, 2009.
Sommaire
Introduction. Les trois Grâces mais pas la grâce ?
livre I la grâce et les grâces : les idées et les images (Anne-Marie Lecoq) p. 19
Première partie. Le socle antique : la charis grecque
– Chapitre 1 – Les Grâces d’Aphrodite et d’Apollon
Les joies du printemps
Les bienfaits d’Apollon
La danse des Charites
Les dons d’Aphrodite
Le plaisir de l’éclat : bronziers, orfèvres et tisserandes
La charis et les Charites dans la poésie érotique
Les premières images des Charites
– Chapitre 2 – La charis du poète, du philosophe et du rhéteur
Le don fait au poète : Pindare
Une qualité de l’âme : Platon
Une qualité du discours : Démétrios et Denys d’Halicarnasse
La venustas des orateurs latins : Cicéron et Quintilien
– Chapitre 3 – La charis du peintre et du sculpteur
Des arts de la parole aux arts figuratifs
Apelle et Praxitèle, artistes « vénusiens »
L’âge d’or de la charis
Matières à délectation
– Chapitre 4 – Les Grâces de la société
Le plaisir d’être reconnu
Philosophie du don et du « lien social » : les trois Grâces enlacées
Les images des trois Grâces enlacées
Épilogue – La grâce inaccessible à l’art ?
Deuxième partie. La grâce chrétienne
– Chapitre 1 – La grâce de l’artiste : l’« Hôte » intérieur
De saint Augustin au moine Théophile
Un peintre en état de grâce : Fra Angelico
Le dessin intérieur
L’artiste « régisseur de la grâce divine »
La grâce d’être né peintre
La grâce, beauté de l’âme : de Benedetto Varchi à André Félibien
– Chapitre 2 – Quand la Grâce transparaît. L’« Épouse » du Cantique
« Réjouis-toi, pleine de grâce ! »
Les images : la jeunesse et l’éclat
« Qu’il me baise d’un baiser de sa bouche » (Cantique, 1, 2)
La Vierge « Douce Amante » : la révolution du sourire et la grâce gothique
– Chapitre 3 – Les bien-aimés de Dieu
Jean-Baptiste l’« ami de l’Époux » et le nouvel Antéros
Daniel « l’homme des désirs » et Jean « le disciple que Jésus aimait »
La jubilation des bienheureux
– Chapitre 4 – Le charme des anges
Les premiers favoris
La grâce de la légèreté et la grâce de l’éclat : l’oiseau étincelant
La grâce de la jeunesse : des nobles dignitaires aux tendres serviteurs
Des anges qui sont des Érotes
La grâce de l’enfance : le triomphe des Amours
Des kerûbhim aux chérubins
La grâce du sourire : de Reims au Bernin
Une grâce troublante : Léonard et l’Ange du désert
Des anges qui sont des Grâces : Piero della Francesca et Caravage
– Chapitre 5 – La nature réconciliée
Le lait de la terre
L’Enfant à la pomme
Le geste du nourrisson
La Madone dans la prairie
Une splendeur née de la poussière : ors et marbres, perles et pierreries
Dans le jardin d’Amour
Épilogue – Les dernières fêtes de la Grâce
Troisième partie. Le retour des trois Grâces
– Chapitre 1 – La réintégration
Au commencement : les Grâces de l’amitié
Les Grâces de Vénus et d’Apollon chez les illustrateurs (xive-xve siècles)
Rimini et Ferrare
– Chapitre 2 – Une triade polysémique
Alberti, Botticelli et la Primavera
Les Grâces néoplatoniciennes
Raphaël et Corrège
– Chapitre 3 – Des Grâces différentes
Poliphile et Gargantua
Les Grâces adossées
– Chapitre 4 – Le hiéroglyphe de la bienfaisance
Les nouveaux mythographes
Les Grâces de la République : Tintoret
Alciat et Valeriano
Les Grâces de l’Iconologie
Trois amies, trois sœurs : de Reynolds à Canova
– Chapitre 5 – Trois Vénus naturelles
Les Grâces en villégiature : Raphaël et Jules Romain
Les Nymphes des sources
Fontainebleau
Concours de beauté
À la fontaine de vie : Rubens
Épilogue – Quelques héritages
livre II l’esthétique de la grâce à l’époque moderne (Alain Mérot) p. 197
Prologue – Trois Grâces, trois Arts
– Chapitre 1 – Beauté et grâce : les secrets de l’art et de l’artiste
Beauté, grâce et venustà dans l’Iconologie de Ripa
La grâce et la manière : quelques questions essentielles
Grâce et beauté à l’époque moderne
Les grâces de l’artiste
Bonne naissance et bonnes manières : la grâce comme qualité sociale
Échanges de dons
Artiste inspiré et « génie »
– Chapitre 2 – Quelques modèles
Ce qui ne s’imite pas ?
La sculpture, des antiques aux modernes
Raphaël
Corrège
Guido Reni
Le Sueur contre Poussin
Reynolds
– Chapitre 3 – Proportions et mouvement
L’architecture rapportée au corps humain : les ordres
Corps gracieux et beauté vénusienne
Les parties du corps et leurs agréments
Poses et postures
Continuité et prévisibilité
L’unité singulière de l’individu
– Chapitre 4 – Ligne, coloris, lumière
Le gracieux comme style « moyen » : brièveté, ornement, suavité
La ligne
Ligne de beauté et ligne de grâce
Coloris et clair-obscur
« Beautés du pinceau » et « légèreté de l’outil »
– Chapitre 5 – Le refus de l’expressif : les grâces contre les passions
Le mode gracieux
L’expression des passions au xviie siècle
« Ces sortes de beautés qui ne durent qu’un moment » : la recherche de la spontanéité dans les attitudes et la danse au xviiie siècle
Les grâces contre les passions au xviiie siècle : les grâces simples de l’enfance
La grâce néoclassique : le danger de la « défiguration »
– Chapitre 6 – Vraies et fausses grâces : le sentiment du xviiie siècle
Les fausses grâces du temps : petits tableaux, petites idées
De l’ornement et de l’arabesque
Sentiment et effusion : une esthétique « sensitive » de la grâce
Naïveté ou mièvrerie : efforts et écueils du néoclassicisme
– Chapitre 7 – Grâce et inquiétude moderne
Néoplatonisme et augustinisme, grâce accessible et grâce dérobée
Le Dieu caché : la grâce au cœur des ténèbres
Le je ne sais quoi et ses enjeux
Sentiment de nostalgie et sensualité chaste : l’influence de Winckelmann
Réactiver la grâce par le sublime et l’inquiétante étrangeté
Grâce souffrante ou grâce inconsciente
Notes p. 445
Bibliographie
Index
Crédits photographiques

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.