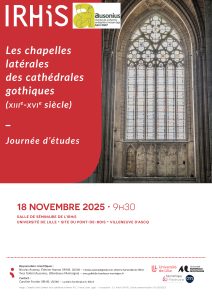 Journée d’études : « Les chapelles latérales des cathédrales gothiques (XIIIe–XVIe siècle) » (Université de Lille, IRHiS, 18 novembre 2025 / en ligne)
Journée d’études : « Les chapelles latérales des cathédrales gothiques (XIIIe–XVIe siècle) » (Université de Lille, IRHiS, 18 novembre 2025 / en ligne)
Argumentaire
La construction de chapelles latérales constitue l’un des aspects marquants de la création architecturale à partir du XIIIe siècle. Arcisse de Caumont, Robert de Lasteyrie et d’autres historiens de l’art ont signalé l’ampleur et l’importance du phénomène. Cependant ces chapelles, longtemps considérées comme de simples additions au corps principal des grandes églises gothiques, comme en témoignent l’affirmation de Viollet-le-Duc dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture française et son choix de les effacer sur son plan publié de la cathédrale d’Amiens, ont souvent été reléguées au chapitre « modifications d’après-coup » de l’histoire des cathédrales.
Depuis quelques années, ces chapelles commencent à retenir pour elles-mêmes l’attention des historiens de l’architecture, des historiens de l’art, des liturgistes, des musicologues, des spécialistes de la dévotion privée, des archéologues qui s’intéressent aux pratiques funéraires.
Tous s’interrogent désormais sur les causes de l’apparition de ces chapelles (accroissement démographique, mutation des pratiques religieuses et dévotionnelles, essor de la dévotion privée et des confréries, essor des fondations commémoratives), aussi bien que sur la chronologie du phénomène et sur sa géographie.
C’est que ces chapelles, qu’elles aient été ajoutées au coup par coup entre les contreforts des bas-côtés d’une nef plus ancienne, qu’elles forment des chefs-d’oeuvre isolés comme la Chapelle des Bourbons à la cathédrale de Lyon, ou qu’elles aient été construites par séries, donc programmées et « loties », comme les chapelles de la nef de la cathédrale de Paris ou de celle d’Amiens, ou encore qu’elles aient été intégrées dès le projet primitif au corps de la nef, entraînent une série de modifications qui sont loin d’être anodines.
Ces modifications touchent d’abord à la qualité de l’espace intérieur de la nef, et à la perception que les fidèles de l’époque comme les visiteurs d’aujourd’hui pouvaient ou peuvent en avoir. En effet, repousser les murs gouttereaux à l’aplomb extérieur des contreforts pour aménager des chapelles dans l’espace ainsi libéré conduit à amplifier l’espace intérieur de la nef. En contrepoint, le déplacement du mur d’enveloppe de la construction contribue à éloigner du vaisseau central les fenêtres qui l’éclairent dans ses parties basses : c’est donc l’atmosphère lumineuse de la nef qui est affectée.
Les modifications peuvent également être d’ordre technique. Étendre l’emprise de l’édifice par un agrandissement latéral exige, par exemple, de repenser l’écoulement des eaux pluviales, donc de modifier le système des toitures des bas-côtés. L’opération peut aussi jouer un rôle dans l’allongement des culées des arcs-boutants, jusqu’à entraîner une reconstruction intégrale des arcs-boutants, comme dans la nef de la cathédrale de Bayeux, ou dans la mise à l’alignement des bras du transept, comme à Notre-Dame de Paris. Et compte tenu de la topographie souvent contraignante des environnements urbains, la question des chapelles latérales implique également de réfléchir aux relations avec les espaces adjacents (trame urbaine, maisons, cloîtres canoniaux, etc.).
La question de l’acoustique ne doit pas être négligée : comment était assurée l’isolation phonique de ces espaces, où les célébrations (messes chantées) ne devaient pas troubler celles qui pouvaient se dérouler dans le choeur ? Pour ne prendre qu’un seul exemple : la Messe de Notre-Dame composée vers 1360-1370 par Guillaume de Machaut, qui a été la première grande messe polyphonique du répertoire occidental, n’était pas destinée à être chantée au choeur, mais à un autel latéral de la cathédrale de Reims.
D’autres points doivent être interrogés : les mécanismes qui ont régi et ordonné l’édification de ces chapelles, les archives qui documentent les fondations de chapelles et de chapellenies, le statut des fondateurs, celui des maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre, celui des personnels affectés au service liturgique de ces chapelles, le mobilier et les objets comme aussi les décors (clôtures, vitrail, peinture murale, retable, sculptures…) associés à ces nouveaux espaces, les gestes qui s’y pratiquaient, le sort de ces chapelles aux époques moderne et contemporaine (accumulation d’objets, restauration par harmonisation ou suppression…) etc.
Enfin, et même si des autels secondaires avaient déjà fait leur apparition dans les grandes églises gothiques, même si des chapelles latérales existaient déjà aux flancs des déambulatoires des chevets, multiplier les chapelles latérales aux côtés des nefs, c’était aussi créer de nouveaux centres d’intérêt, dans un espace jusqu’alors fortement centré sur le sanctuaire et le choeur liturgique. La nouvelle polarisation de l’espace intérieur a donc eu un impact tout autant fonctionnel que circulatoire, l’édification de chapelles latérales revenant à modifier la relation entre le centre et les périphéries internes de ces églises.
Ce sont ces thèmes et ces questions que nous proposons d’aborder dans les deux journées d’études qui se tiendront, l’une, à Lille en 2025, l’autre, à Bordeaux en 2027.
Programme
9h30 Accueil
9h45 Ouverture
Charles MÉRIAUX, IRHiS, ULille
10h00 Introduction
Étienne HAMON, IRHiS, ULille
10h30
Présidente de séance : Élise BAILLIEUL, IRHiS, ULille
Nicolas ASSERAY, ANR ALTIOR, IRHiS, CNRS
Les voûtes complexes des chapelles de la nef de la cathédrale d’Amiens
Michalis OLYMPIOS, UChypre
Les chapelles des travées droites du choeur de la cathédrale de Beauvais
Julie CLAUSTRE, ICT, UParis Cité
Darwin SMITH, LAMOP, UParis1 Panthéon–Sorbonne
Les chapelles de Notre-Dame de Paris dans le miroir des sources capitulaires (1326-1504)
Discussions
13h00 Déjeuner
14h00
Présidente de séance : Alexandra GAJEWSKI, Burlington Magazine, Institute of Historical Research, London
Yves GALLET, Ausonius, UBordeaux Montaigne
Les chapelles de la nef de la cathédrale de Bayonne
Philippe PLAGNIEUX, HiCSA, UParis1 Panthéon–Sorbonne
La chapelle de Vendôme de la cathédrale de Chartres
Jean-Vincent JOURD’HEUIL, CERCOR, UJean Monnet–Saint Étienne
Les chapelles de la cathédrale de Bourges
Discussions
16h00 Fin de la journée
Responsables scientifiques
Nicolas Asseray – nicolas.asseray @ gmail.com
Étienne Hamon – etienne.hamon @ univ-lille.fr
Yves Gallet – yves.gallet @ u-bordeaux-montaigne.fr
Informations pratiques
Salle de séminaire de l’IRHiS (A1.152à, ULille, Campus du Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq
Journée en hybride -> lien zoom— ID de réunion: 915 5346 3954 — Code secret: 602287
Source : IRHiS

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.