Journée d’études « Archives et histoire de l’art »
Strasbourg, Misha, salle des conférences, 7 novembre 2025, 9h30-18h
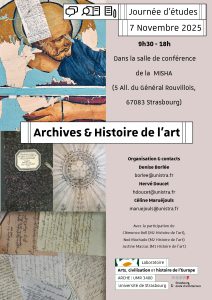 Si le travail de l’historienne et de l’historien de l’art s’articule nécessairement autour des œuvres, les archives constituent une source de premier choix pour les aborder. Documents écrits ou fonds iconographiques, les archives privées ou publiques regorgent d’informations sur les acteurs de la création. Le recours à cette documentation permet de retracer l’histoire des objets étudiés en levant le voile sur le processus créatif, les déplacements et les interventions dont certains d’entre eux portent encore la trace. Du travail collaboratif de l’artiste au choix du sujet et des matériaux, les archives peuvent nous renseigner sur le contexte et les mécanismes de la création intellectuelle, comme sur la matérialité des œuvres. Leur usage en histoire de l’art a fait l’objet de publications récentes (L’histoire de l’art à la source, dir. I. Chave et P. Sénéchal, 2024 ; la revue Histoire de l’art, nos 95, juin 2025 et 96, décembre 2025) ouvrant la voie à nos échanges sur l’objet archivistique dans l’étude des arts. Socle de la recherche historique, le document d’archive fonde la scientificité d’une discipline bien éloignée du connoisseurship des XVIIe et XVIIIe siècles. Aussi permet-il d’ancrer la production artistique dans l’histoire tout en l’éclairant à son tour par l’analyse des objets d’étude. Dans cette confrontation de l’œuvre aux archives, il faut toutefois considérer leur langage respectif, leur propre dynamique et leur intentionnalité singulière. À l’instar de toute autre source, les archives doivent être critiquées, leur rapport à la vérité, questionné. Les interventions font rencontrer l’œuvre et ses archives pour un dialogue riche d’enseignements et de perspectives de recherche en histoire de l’art du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Elles questionnent l’intérêt heuristique de cette rencontre, tout en discutant des enjeux de méthode et d’épistémologie autour de l’usage, de la valeur et de la portée des archives. À bien des égards, cette
Si le travail de l’historienne et de l’historien de l’art s’articule nécessairement autour des œuvres, les archives constituent une source de premier choix pour les aborder. Documents écrits ou fonds iconographiques, les archives privées ou publiques regorgent d’informations sur les acteurs de la création. Le recours à cette documentation permet de retracer l’histoire des objets étudiés en levant le voile sur le processus créatif, les déplacements et les interventions dont certains d’entre eux portent encore la trace. Du travail collaboratif de l’artiste au choix du sujet et des matériaux, les archives peuvent nous renseigner sur le contexte et les mécanismes de la création intellectuelle, comme sur la matérialité des œuvres. Leur usage en histoire de l’art a fait l’objet de publications récentes (L’histoire de l’art à la source, dir. I. Chave et P. Sénéchal, 2024 ; la revue Histoire de l’art, nos 95, juin 2025 et 96, décembre 2025) ouvrant la voie à nos échanges sur l’objet archivistique dans l’étude des arts. Socle de la recherche historique, le document d’archive fonde la scientificité d’une discipline bien éloignée du connoisseurship des XVIIe et XVIIIe siècles. Aussi permet-il d’ancrer la production artistique dans l’histoire tout en l’éclairant à son tour par l’analyse des objets d’étude. Dans cette confrontation de l’œuvre aux archives, il faut toutefois considérer leur langage respectif, leur propre dynamique et leur intentionnalité singulière. À l’instar de toute autre source, les archives doivent être critiquées, leur rapport à la vérité, questionné. Les interventions font rencontrer l’œuvre et ses archives pour un dialogue riche d’enseignements et de perspectives de recherche en histoire de l’art du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Elles questionnent l’intérêt heuristique de cette rencontre, tout en discutant des enjeux de méthode et d’épistémologie autour de l’usage, de la valeur et de la portée des archives. À bien des égards, cette
journée d’étude met en valeur la richesse de l’actualité de la recherche en témoignant encore et toujours des apports de l’enquête archivistique.
Programme
9h30 Accueil
10h Delphine Wanes (doctorante, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, secrétaire de rédaction d’Histoire de l’art), présentation de la revue
10h30 Denise Borlée (maître de conférences, université de Strasbourg) et Emmanuel Lamouche (maître de conférences, Nantes Université), présentation des nos 95 et 96 « Archives »
11h Discussion
11h15 David Bourgeois (responsable des archives de Saint-Louis agglomération) et Caroline Danforth (chargée de conservation, National Gallery of Art, Washington, D.C.), « Une enquête archivistique mouvante : le cas du canon d’autel des Clarisses de Mulhouse »
12h Discussion
Pause repas
14h30 Lucas La Barbera (doctorant, université de Strasbourg), « Quelles sources pour étudier un chantier gothique avant 1200 ? Le cas de Saint-Marcel de Prémery (58) »
15h Jade Durand (INP-École du Louvre), « Documenter les restaurations de peintures murales par les archives : Saint-Michel de Weiterswiller »
15h30 Quentin Despond (doctorant, université de Strasbourg), « La restauration de la maison Kammerzell à Strasbourg par Eugène Dock (1881-1883) : une remise en état “formellement mathématique” »
16h Pause café
16h30 Martial Guédron (professeur, université de Strasbourg), « Dessiner à la lampe : ce que les archives révèlent de l’éclairage artificiel dans les académies d’art européennes (1750-1800) »
17h Fanny Kieffer (maître de conférences, université de Strasbourg), « Quelles typologies d’archives pour reconstituer les collections à l’époque moderne »
17h30 Gauthier Bolle (professeur, ENSAS), « Abriter et incarner les institutions européennes : aux sources d’une histoire architecturale urbaine »
Une présentation des numéros 95 et 96 de la revue Histoire de l’art sur le thème des archives aura également lieu à l’université de Nantes le 16 décembre 2025.

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.