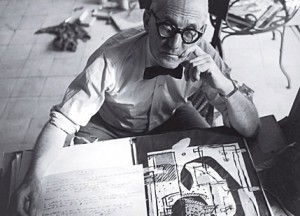 Appel à communications : Colloque Le « moment 1925 » : Le Corbusier. Urbanisme, architecture, peinture, « arts décoratifs », édition (Paris, décembre 2025)
Appel à communications : Colloque Le « moment 1925 » : Le Corbusier. Urbanisme, architecture, peinture, « arts décoratifs », édition (Paris, décembre 2025)
Paris, semaine du 15 décembre 2025
Présentation
« Un moment n’est pas long ; un instant est encore plus court ».
Article « Moment », dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot et M. d’Alembert[1].
Alors qu’en 1925, Le Corbusier (avec Pierre Jeanneret) présente au sein de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes une œuvre affichée comme « une synthèse totale de toute [ses] recherches » mais aussi comme « un pavé au milieu des arts décoratifs »[2] – le Pavillon de l’Esprit Nouveau –, ce que l’on choisit de nommer le « Moment 1925 » peut être plus largement considéré comme un espace-temps fondamental dans l’œuvre et la pensée de l’architecte pluriel et de son Atelier. Moment d’aboutissement de recherches menées depuis parfois quinze années sur les questions architecturales, urbanistiques, « décoratives », picturales ou éditoriales, il est aussi en conséquence un nouveau commencement pour l’artiste qui jouit alors d’une notoriété grandissante en France et au-delà, et débute un amendement à ses principes ou parfois leur révision : un moment de bascule[3]. Ce moment de bascule marque un temps de recherches parfois contradictoires où équilibre et mouvement vers de nouveaux programmes ou théories dialoguent. Il ne possède pas de bornes chronologiques strictes, mais mouvantes selon l’objet analysé ou l’analyse elle-même, tels des cercles variablement définis par les branches d’un compas ; communément associé à un « Esprit Nouveau »[4], ce moment en démultiplie les incarnations et les interprétations tout en les franchissant pour trouver diverses caractérisations. Une « Révolution intellectuelle ? »[5] Un « moment conceptuel »[6] ? Un moment de « paradoxe »[7] ?
C’est donc ce « Moment 1925 » au cœur duquel agit et pense Le Corbusier que nous souhaitons interroger et explorer en cette année du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, au cours de laquelle se sont tenus et se tiendront encore plusieurs événements consacrés à l’Exposition elle-même ou aux manifestations de ce qui fut plus tard nommé « Art déco »[8]. Ici, nous souhaitons dépasser l’événement sans pour autant nier les conséquences qu’il engendre[9], en interrogeant spécifiquement les mouvements d’un artiste et de son œuvre pluridisciplinaire, les dynamiques qui les accompagnent, les traversent ou les bousculent sur un « laps de temps » un moment « fécond »[10].
Ainsi, trente-huit ans après la tenue de l’exposition « L’Esprit nouveau. Le Corbusier et l’industrie 1920-1925 » et la publication de son éminent catalogue, nous souhaitons poursuivre certaines des réflexions fondatrices alors menées en en élargissant les contours, en en faisant évoluer l’objet d’étude et en en actualisant les résultats, grâce à des interventions de chercheurs de divers champs disciplinaires. Les nombreuses recherches publiées depuis sur des problématiques dépassant la question de l’industrie ou celle de l’Esprit Nouveau constituent évidemment d’autres points d’ancrage. Dès lors, toute recherche inédite ou toute relecture d’un thème déjà étudié trouvera sa place au sein de ce colloque qui se veut interdisciplinaire, comme le fut l’œuvre de Le Corbusier, et international, comme le furent sa production – « la planète comme chantier »[11] – et sa réception. Seront alors privilégiées les interventions proposant des approches transversales et évitant les études de cas sauf si celles-ci permettent une analyse décloisonnée, l’ensemble devant prévaloir sur le fragment.
Lors de ce colloque, les interventions pourront ainsi porter sur :
-La notion de « moment », ses définitions et ses conditions. Le regard et les discours portés par Le Corbusier sur ce « Moment 1925 », le sien, celui des autres, le leur.
Sans que la figure de Le Corbusier soit jamais exclue du propos, la notion de « moment » elle-même pourra faire l’objet d’interventions, plus particulièrement si ces dernières permettent d’interroger sa définition en la rattachant à l’objet d’analyse. En outre, si Le Corbusier proclame l’avènement d’une « grande époque »[12] et propose en 1925 un panorama du « dernier quart de siècle » – « Témoins » – ainsi qu’une première autobiographie – « Confession »[13] –, on pourra se questionner sur la manière dont il juge ce « présent » dans toute sa pluralité[14], comment il le considère et comment il s’y insère : moment « propice à » ou décisif ? Point de rupture ou d’équilibre ? Moment de transition ou de liaison ? Moment de tradition ou d’innovation ? Moment de fondation ? Moment qui naît ou qui s’achève ? Moment destiné à durer ? Moment de révolution ? De même, nous pourrons nous interroger sur ce que Le Corbusier regarde ou ne regarde pas, voire ne comprend pas, afin de mieux saisir les enjeux de l’époque et la manière dont il s’en empare ou non.
Ici, nous espérons dépasser ou déconstruire la vision parfois caricaturale d’un artiste en rupture radicale avec certains acteurs ou certaines postures pour mieux donner à voir les nuances, les tensions voire les contradictions de son œuvre et de sa pensée. Comme l’affirme Catherine Chevillot à propos de la sculpture des premières années du XXe siècle : « Dans l’espace de ces oppositions apparentes peuvent apparaître des convergences inattendues et s’élaborer de nouvelles perspectives d’analyse »[15]. Ici, les ancrages et les développements théoriques de l’architecte-penseur pourront aussi être discutés. Enfin, au-delà de l’analyse ou du discours produits, des études portant sur les formes et les moyens employés par Le Corbusier dans ce contexte seront bienvenues.
-L’œuvre et la situation professionnelle (artistique et intellectuelle) de Le Corbusier au milieu des années 1920.
La première moitié des années 1920 correspond à la naissance de l’Atelier de la rue de Sèvres, à l’association avec Pierre Jeanneret, à la conception théorique de villes « contemporaines » ainsi qu’à l’édification d’une cité ouvrière et de maisons dites puristes, expressions plastiques du monde machiniste. En 1925, les deux noms apparaissent à part égale sur les cartons d’invitation et le Rapport de l’Exposition. Quant aux articles parus dans la presse à cette occasion, ils démontrent que l’architecte est sans conteste une figure centrale et désormais établie d’une modernité radicale française[16]. Dans la seconde moitié de la décennie, de manière inédite, l’Atelier accueille deux femmes dans des conditions et pour une mission différentes, augurant un nouveau rapport au féminin, ainsi que plusieurs « jeunes » architectes, souvent suisses, actant la dimension internationale de cette agence qui n’en porte pas le nom. L’œuvre, les théories et les programmes de Le Corbusier évoluent avec, entre autres, une application renforcée des principes du taylorisme ou une ouverture vers des programmes de plus grande envergure et plus complexes.
Ainsi, d’abord, dans la continuité relative des dernières Rencontres de la Fondation Le Corbusier[17], l’Atelier tel qu’il s’organise, fonctionne et se développe spécifiquement au milieu des années 20, mais aussi les modalités des collaborations professionnelles et intellectuelles au sein et hors de l’Atelier, parfois invisibles comme Paulette Bernège[18], pourront être explorées. Par ailleurs, les réalités (programmatiques, intellectuelles, institutionnelles, politiques et sociales) dans lesquelles Le Corbusier pense et agit pourront faire l’objet d’analyses alors que la période voit naître nombre de ses grands paradigmes (« invariants », « immeuble-villas », « promenade architecturale », « Cinq points de l’architecture moderne », polychromie architecturale, « casier standard », « nouvelles manières de s’asseoir », etc.) et évoluer les programmes auxquels l’Atelier a l’occasion de se confronter.
Puis, l’œuvre corbuséenne dans toute sa diversité, qu’elle soit théorique ou appliquée, et ses procédés et processus, pourront donner lieu à des communications dont nous souhaitons qu’elles évitent une approche monographique pour privilégier une lecture transversale, relationnelle (entre les œuvres) ou tendancielle (en lien avec l’idée de « moment »). Ici, les présentations de recherches inédites portant sur les éléments de l’architecture, les méthodes, les procédés, les techniques et la matérialité sont vivement espérées alors que plusieurs travaux récents ont, par exemple, remis en cause la monochromie blanche des façades des maisons puristes et révélé la mise en œuvre d’enduits « ton pierre(s) » ou de polychromies. Sont également attendues des réflexions relatives à des mouvements de circulations au sein même de l’œuvre de Le Corbusier et au questionnement sur les concordances entre discours et actions.
-Modernité-modernités : polémiques, débats, terminologies, polysémie.
À plusieurs reprises, l’architecte expose les conditions difficiles dans lesquelles il bâtit au sein d’événements officiels, tel celui de l’Exposition de 1925, et l’hostilité à laquelle il doit faire face dans une France qu’il juge aveugle – « des yeux qui ne voient pas… » – et dont « l’esprit fâcheux […] pèse »[19]. Les critiques de Paul Léon, par exemple, à l’égard de ses propositions stigmatisent plus largement les positions des artistes et architectes « très moderne[s] »[20]. Ainsi, au milieu de la décennie, notamment en France, Le Corbusier cristallise les débats autour de la modernité et incarne une alternative, une voie pour certains délétère, « figure scandaleuse sur la scène parisienne »[21], pour d’autres héroïque[22].
Dès lors, ce colloque sera l’occasion d’examiner les débats et polémiques auxquels Le Corbusier prend alors part ou dans lesquels il est pris malgré lui, en France et à l’étranger. Elles pourront également interroger les termes ou notions de « nouveau », de « modernité », d’« antimodernité »[23], de « modernisme »[24] ou de « fonctionnalisme », au sein d’une époque où nombreux sont ceux qui se revendiquent comme « modernes » tandis que, selon Jean-Louis Cohen, Le Corbusier « s’attache le plus souvent à éviter d’associer l’épithète ‘moderne’ au substantif ‘architecture’ »[25], comme en atteste d’ailleurs le titre de son ouvrage manifeste Vers une architecture. Dans ce contexte, il sera intéressant de s’interroger sur la manière dont Le Corbusier se définit lui-même et est défini, qualifié, compris ou mécompris par les autres (Français et étrangers, commentateurs et créateurs – architectes, décorateurs, écrivains ou, sans être exhaustif, peintres –, proches et moins proches, etc.). Pourra aussi être étudié le rapport de Le Corbusier, entre autres, au « néo-traditionalisme », au vernaculaire ou au régionalisme, alors que les années trente sont considérées par les historiens comme le lieu d’éclosion concret de sa sensibilité poétique. De même, les réflexions sur la notion de « style » et la manière dont l’architecte la récuse auront ici toute leur place[26], tout comme celles portant sur le corps ou la fabrique d’un homme (et d’une femme) moderne, figure « énergique, habile, sain[e] » qui « garde la tête froide et fait preuve de rigueur »[27]. Ce colloque devrait également permettre d’explorer finement des notions et des terminologies forgées, empruntées ou dévoyées par l’artiste au cours de ces années et souvent pérennes, comme celles de « standard » ou de « type », afin de déconstruire et d’affiner des chronologies, mais aussi d’interroger les sens qu’il leur donne au sein d’un contexte international.
Enfin, pourront aussi être poursuivies les réflexions sur le contenu et la forme des publications de Le Corbusier, telle la revue L’Esprit Nouveau dont les commissaires de l’exposition de 1987 jugeaient l’« image graphique et typographique […] traditionnelle et même banale »[28], et ce, ici aussi, dans un contexte international.
-Les rôles de Le Corbusier et ses milieux. Réseaux, échanges, diffusion.
Au milieu des années 1920, Le Corbusier se targue de participer à l’éclosion d’« un phénomène architectural absolument neuf, inédit »[29] ; tout à la fois, il peint, écrit, publie, édite, expose, projette, construit ou prophétise… Entre 1918 et 1925, il publie cinq ouvrages de définition de ses théories dans des champs aussi divers que la peinture, l’urbanisme, l’architecture et les arts décoratifs. Entre 1920 et 1925, L’Esprit Nouveau, « revue internationale illustrée de l’activité contemporaine », se donne pour ambition de « faire comprendre l’esprit qui anime l’époque contemporaine ; faire saisir la beauté de cette époque, l’originalité de son esprit ; démontrer que cette époque est aussi belle que celles du passé où l’on voudrait avoir vécu. Montrer l’esprit unitaire qui anime dans leurs recherches les différentes élites de notre Société »[30]. Aux Salons d’Automne, à la Bauhaus Woche, à la Galerie Druet, au Salon des Indépendants, à la Galerie de l’Effort moderne, à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, à Stuttgart, à Francfort ou encore à Turin, il expose ses toiles, exprime publiquement ses idées ou diffuse ses projets de logements et de villes modernes à travers divers procédés, dont celui de la photographie. Son réseau se déploie, ses relations se consolident, sa clientèle s’accroît. Comme en attestent les archives conservées à la Fondation Le Corbusier, la décennie, et peut-être plus encore son mitan, correspond à un moment essentiel de construction d’un réseau polymorphe et international, Le Corbusier n’hésitant pas, par exemple, à solliciter des acteurs du monde machiniste pour permettre la réalisation de son œuvre. Le financement et la publicisation de son œuvre bâtie et écrite s’inscrit ainsi dans une logique moderne capitaliste. En outre, davantage que les architectes semble-t-il, les sculpteurs et les peintres (et peut-être les galeristes) comptent parmi les figures majeures de son réseau artistique et amical. Pour autant, alors que des groupements d’architectes français se forment avant 1925 (comme le G.A.M. puis S.A.M.[31]), la seconde moitié des années 1920 correspond à la création de regroupements d’architectes modernes dont les Congrès Internationaux d’Architecture Moderne créés en 1928, au sein desquels Le Corbusier jouera un rôle important.
En outre, la relation de Le Corbusier avec la presse, en particulier professionnelle, ou le monde de l’édition en général, prend à cette époque une dimension inédite. Ainsi, de très récents travaux ont commencé à démontrer le rôle majeur joué dès 1925 par Christian Zervos et Jean Badovici, et plus largement par les éditions Morancé, dans la défense et la diffusion de sa production urbanistique, architecturale et mobilière[32]. Il s’agirait ici plus largement de s’intéresser aux modalités de diffusion de sa pensée et de son œuvre quelle qu’elle soit et aux logiques d’exposition de ses idées.
Ainsi, ces deux journées seront l’occasion d’observer la manière dont l’architecte conçoit sa position et sa mission au sein du monde machiniste et quels milieux il pénètre. Comment procède-t-il ? Quels canaux utilise-t-il ? Ses réseaux se rencontrent-ils ? Quels acteurs et quels types d’acteurs intègrent son monde à cette époque précisément ? Selon quelle logique et avec quelle pérennité ? Mais aussi quel rôle Le Corbusier souhaite-t-il se donner et quelles sont ses stratégies pour diffuser ses idées et son œuvre ? L’une et les autres sont-elles toujours compatibles ? Quels procédés ou modes de représentation sont mis en place ? Sa posture est-elle originale ?
-Réception, interprétations et historiographie.
« Car pour moi […] toute l’architecture d’aujourd’hui, celle que l’histoire l’enregistrera [sic], la sacro-sainte, celle qui rendra l’homme heureux est le triptyque Oud-Le Corbusier-Gropius, que notre siècle retiendra pour pouvoir la bénir un jour »[33].
Lors de ce colloque que nous désirons ouvert, nous souhaitons vivement que la question de la réception, immédiate ou différée, nationale et internationale, ainsi que celle de l’historiographie de ce « Moment 1925 » corbuséen soient explorées.
L’impact de la revue L’Esprit Nouveau, de l’ouvrage Vers une architecture ou du Pavillon de l’Esprit Nouveau, par exemple, dans des pays aussi divers que l’URSS, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Tchécoslovaquie, la Turquie, la Suède ou le Japon, est concret. Déjà étudié pour certaines géographies, ces « lendemains » restent à explorer pour d’autres, au sein d’une démarche qui rejoint celle de l’analyse des milieux corbuséens. Nous souhaitons que la variété des territoires artistiques et intellectuels investis par Le Corbusier soit ici prise en compte afin de montrer combien son œuvre dans toutes ses expressions et dimensions, suscite des réflexions, des réactions, des interprétations voire des appropriations[34], par des acteurs de toutes confessions et de toutes nationalités, et qui peuvent, pour certains, en déformer la substance jusqu’à la dénaturer parfois. Dans ce cadre, l’étude des modalités et des acteurs engagés dans ces transferts vers un ailleurs géographique sera elle aussi bienvenue.
Enfin, très tôt, divers acteurs, dont des chercheurs, se sont emparés des enjeux complexes des réflexions de Le Corbusier et de ses collaborateurs sur l’Esprit Nouveau et le Purisme, ou ont tenté d’analyser à travers diverses méthodes ses postures de projet, ses « inventions » spatiales, ses conceptions picturales, sa production mobilière ou la réception de certaines de ses réalisations[35]. Ce colloque pourra ainsi être l’occasion de proposer une approche historiographique de ce « Moment 1925 » corbuséen afin d’intégrer un regard réflexif et critique sur les approches mises en œuvre ces cinquante dernières années.
Ces quelques thèmes ne le sont qu’à titre indicatif. Les propositions de communications peuvent en effet porter sur d’autres problématiques ou questionnements dès lors qu’ils sont en lien avec le thème énoncé.
Ce colloque se tiendra sur deux journées à Paris.
Les interventions pourront se faire en français ou en anglais.
Une publication est envisagée à l’issue du colloque, dont les conditions sont à définir.
Calendrier
Lancement de l’appel à communications : juillet 2025.
Envoi des propositions : 12 septembre 2025.
Retour acceptation des propositions : 26 septembre 2025.
Colloque : semaine du 15 décembre 2025.
Modalités d’envoi des propositions de communications
Les propositions de communications de 2000 signes espaces compris maximum incluront un titre et une courte biographie de l’intervenant (500 signes espaces compris maximum). Le caractère inédit de la recherche et la problématique développée seront clairement mis en avant.
Le document envoyé doit être ainsi nommé : NOM-Prénom_Moment1925LC.
Les propositions sont à envoyer avant le 12 septembre 2025 aux deux adresses suivantes :
benedicte.gandini@fondationlecorbusier.fr
elise.koering@strasbourg.archi.fr
Comité d’organisation
Bénédicte Gandini (Architecte-historienne, Fondation Le Corbusier).
Elise Koering (Maîtresse de conférences en Histoire et Cultures Architecturales, ENSA de Strasbourg, UMR 3400 ARCHE—Université de Strasbourg-ENSAS. LACTH-ENSAP de Lille).
Comité scientifique
Raphaèle Billé (Assistante de conservation au Musée des Arts décoratifs de Paris), Olivier Cinqualbre (Conservateur honoraire du Musée Nationale d’Art Moderne-Centre de Création Industrielle-Centre Pompidou), Rossella Froissart (Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études. Section des Sciences Historiques et Philologiques), Bénédicte Gandini (Architecte-historienne, Fondation Le Corbusier), Elise Koering (Maîtresse de conférences en Histoire et Cultures Architecturales, ENSA de Strasbourg, ENSA de Strasbourg, UMR 3400 ARCHE—Université de Strasbourg-ENSAS. LACTH-ENSAP de Lille) et Gilles Ragot (Professeur émérite de l’Université de Bordeaux-Montaigne).
[1] Cité par Françoise Balibar, Philippe Büttgen, Jean-Pierre Cléro, Jacques Collette et Barbara Cassin, « Moment, instant, occasion », Trivium [En ligne], 15 | 2013, mis en ligne le 09 décembre 2013. URL : http://journals.openedition.org/trivium/4638 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trivium.4638
[2] Lettre de Le Corbusier à ses parents, 9 février 1925. Fondation Le Corbusier R1(6)197.
[3] Renée Houde, « La théorie de la bascule », dans Martine Lani-Bayle (Dir.), Les bascules de la vie. 2005, 2-84273-487-4.hal-01245649, p. 36-47.
[4] Voir, notamment, L’Esprit Nouveau. Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, Zürich, Berlin, Strasbourg, Paris, Ernst & Sohn, 1987 ; Claude Garino, Le Corbusier. De la villa turque à l’Esprit nouveau, La Chaux-de-Fonds, Idéa : l’Os du crocodile, 1995 ; Ducros Françoise, « L’Esprit nouveau » : le purisme à Paris, 1918-1925 : Grenoble, Musée de Grenoble, 7 octobre 2001-6 janvier 2002. Collab. de Serge Lemoine, Carol S. Eliel, Françoise Ducros et al. Paris ; Grenoble : Réunion des musées nationaux, Musée de Grenoble, 2001.
[5] Pour reprendre l’interrogation formulée par Stanislaus von Moos en 1987, elle-même inspirée des écrits de Robert Musil. Stanislaus von Moos, « Dans l’antichambre du ‘Machine Age’ », L’Esprit Nouveau. Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, op. cit., p. 15.
[6] Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Paris, Éditions Gallimard, p. 26.
[7] En écho au « troisième paradoxe de l’esthétique du nouveau » analysé par Antoine Compagnon, dans Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990, p. 12.
[8] Les années 25 : Art Déco/Bauhaus/Stijl/Esprit Nouveau, Paris, Musée des arts décoratifs, 3 mars-16 mai 1966. Voir Élodie Lacroix, « Qu’est-ce que l’Art Déco ? », dans Élégance & modernité : l’illustration au temps de l’art déco, catalogue d’exposition, sous la direction de Christophe Didier et Catherine Soulé-Sandic ; avec la collaboration scientifique d’Élodie Lacroix, Strasbourg : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 2025, p. 11-17.
[9] « Morceau de temps, l’événement est encore un créateur : il crée du temps qui suit son accomplissement, il crée des relations et des interactions, des confrontations ou des phénomènes de consentement, il crée du langage, du discours. On peut encore dire qu’il crée de la lumière parce qu’il révèle soudain des mécanismes jusque-là invisibles ». Arlette Farge, « Penser et définir l’événement en histoire », Terrain [En ligne], 38 | 2002, mis en ligne le 06 mars 2007. URL : http://journals.openedition.org/terrain/1929 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.1929
[10] Dans Laocoon ou Des frontières respectives de la poésie et de la peinture (1766-1768), Gotthold Ephraim Lessing déclare que l’« instant fécond » ou « instant prégnant » n’est pas l’instant le plus extrême ou paroxystique, mais celui qui laisse libre cours à l’imagination.
[11] Jean-Louis Cohen, Le Corbusier. La planète comme chantier, Textuel, 2015.
[12] L’Esprit Nouveau, n° 1, octobre 1920.
[13] Tous deux publiés dans L’Art décoratif d’aujourd’hui en 1925.
[14] Nous connaissons ses positions sur « l’épanouissement » de « l’esthétique de l’ingénieur » face à la « pénible régression de l’architecture ». Le Corbusier-Saugnier, « Esthétique de l’ingénieur. Architecture », L’Esprit Nouveau, n° 11-12, janvier 1921.
[15] Citation complète : « Dans l’espace de ces oppositions apparentes peuvent apparaître des convergences inattendues et s’élaborer de nouvelles perspectives d’analyse de la période ». Catherine Chevillot, La sculpture à Paris ; 1905-1914, moment de tous les possibles, Éditions Hazan Bibliothèque, 2017, p. 8.
[16] « On sait quelle ampleur Le Corbusier a donné à la standardisation, la maison devenant la “machine à habiter”. En opposition avec l’utilitarisme radical, le principe de la maison-type, on constate une tendance à sauvegarder ce que l’on a appelé “les droits du superflu”, à maintenir tout ce qui arrache l’homme moderne à l’automatisme ». Paul Léon (sous la dir.), Rapport général, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, section artistique et technique, volume XIII, Larousse, 1927, p. 53.
[17] « L’envers et l’endroit de l’atelier du 35 rue de Sèvres de 1924 à 1965 ». XXIIèmes Rencontres de la Fondation. Paris. 5 et 6 décembre 2024.
[18] Elise Koering, « Architecte ménagère. Une nouvelle experte de l’habitat des années 1920 », Source(s) (Presses Universitaires de Strasbourg). Numéro thématique sur les « Femmes expertes », 2016, p. 103-117.
[19] Lettre de Le Corbusier au Chef de cabinet du Commissariat général de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 27 mai 1925. Archives de la Fondation Le Corbusier A1-5-1.
[20] « Il vient de se produire à l’Exposition des arts décoratifs un incident qui causa un vif émoi dans les milieux intéressés. MM. Fernand David, commissaire général de l’Exposition, et Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, visitaient samedi dernier l’’ambassade française moderne’ : Ils en étaient encore au vestibule, construit par M. Mallet-Stevens, et sur les murs duquel l’architecte avait placé deux panneaux décoratifs, l’un de M. Fernand Léger, l’autre de M. Robert Delaunoy (sic.). Les deux visiteurs officiels jugèrent sévèrement ces deux panneaux, de tendance très moderne, on le conçoit, étant donné la personnalité des auteurs, et ils exprimèrent tout haut leur sentiment défavorable. […] donnèrent l’ordre de retirer les panneaux de MM. Léger et Delaunoy ». « Un incident très commenté aux arts décoratifs », Excelsior, 1er juin 1925, p. 1-2.
[21] Jean-Louis Cohen, L’architecture au futur depuis 1889, Phaidon, 2012, p. 128.
[22] « La lucidité des conceptions de Le Corbusier, le caractère perfectible de ses excellentes réalisations, tout cela me donne confiance. J’ai le sentiment très net qu’il est sur la bonne voie, celle qui mène quelque part, très loin de l’Exposition, des corbeilles de fruits et des éventails ». Francis Jourdain, « L’Exposition est close : Les résultats », Le Bulletin de la vie artistique, année 6, n° 22, novembre 1925, p. 494-495.
[23] Selon Antoine Compagnon, les antimodernes sont « les modernes en délicatesse avec les temps modernes, le modernisme ou la modernité, ou les modernes qui le furent à contrecœur, modernes déchirés ou encore modernes intempestifs ». Antoine Compagnon, Les antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005, p. 7.
[24] Dans L’Architecture française, publié en 1938, Marie Dormoy définit « trois tendances » architecturales françaises après la guerre de 1914-1918 : l’« architecture classique », l’« architecture moderniste » et l’« architecture académique » (p. 138). « L’architecture moderniste a pour chef Le Corbusier. Auteur de nombreux et importants ouvrages théoriques, Le Corbusier a relativement peu construit, mais chacune de ses œuvres est une affirmation, presque une déclaration de guerre. Elles sont plus plastiques que constructives, la structure étant presque toujours dissimulée derrière de grandes surfaces planes. Par là il affirme sa théorie que ‘l’architecture est un jeu savant, correct et magnifique, des volumes assemblés sous la lumière’ » (p. 140).
[25] Jean-Louis Cohen, Architecture du XXe siècle en France : Modernité et continuité, Hazan, 2014, p. 62.
[26] « … ‘principes’ et non ‘style’, la différence est d’importance » écrit Yannis Tsiomis dans « L’art décoratif d’aujourd’hui et ‘la loi du Ripolin’ », dans L’année 1925. L’esprit d’une époque, Sous la direction de Myriam Boucharenc et Claude Leroy, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2021.
[27] Hermann Hesse, Le loup des steppes, Suhrkamp Verlag, 1927 (trad. française Alexandra Cade), Calmann-Lévy, 2004, p. 232.
[28] Stanislaus von Moos, op. cit., p. 13.
[29] À propos des maisons de Pessac. Lettre de Le Corbusier à Marie-Charlotte Amélie, 26 mai 1926. Archives de la Fondation Le Corbusier R1(6)125-126.
[30] L’Esprit Nouveau, n° 1, 1920.
[31] Léna Lefranc-Cervo, La Société des architectes modernes (1922-1946) : stratégies professionnelles et postures intellectuelles d’un réseau d’architectes, thèse de Doctorat, Université Rennes 2, sous la direction d’Hélène Jeannière, 2024.
[32] Théo Koenig, La diffusion et la réception du pavillon de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier en France entre 1925 et 1930. Mécaniques de diffusion et de réception d’une œuvre d’avant-garde de l’architecture moderne à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, Mémoire sous la direction d’Elise Koering, École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, juin 2025.
[33] Lettre de Jean Badovici à J.J.P. Oud, 21 septembre 1925, août 1930. Archives J.J.P. Oud, N.A., Rotterdam B53-88.
[34] On peut penser au « Pas la peine de se gêner… » adressé par Le Corbusier à Antonin Raymond.
[35] Citons, sans être exhaustifs, Jean-Louis Cohen évidemment, mais également Tim Benton, Philippe Boudon, Luisa Martina Colli, Beatriz Colomina, Françoise Ducros, Françoise de Franclieu, Giuliano Gresleri, Stanislaus von Moos, Carlo Olmo, Francesco Passanti, Danièle Pauly, Gilles Ragot, Bruno Reichlin, Arthur Rüegg, Nancy Troy ou encore Françoise Will-Levaillant…
Télécharger l’appel en français :APPEL_COLLOQUE MOMENT 1925 LE CORBUSIER-1
Télécharger l’appel en anglais : CALL FOR PAPERS_COLLOQUIUM 1925 MOMENT LE CORBUSIER

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.