PROLONGATION DE LA DATE LIMITE AU 1er DÉCEMBRE 2016.
Liée ou pas à l’atteinte à la vie privée, la diffamation constitue, d’après la Loi du 29 Juillet 1881 en France, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. » Selon une décision prise le 1er août 1994 par la Cour d’appel du Québec, il s’agit de « la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». Les lois qui règlementent la diffamation aux États Unis sont en conflit avec le Premier amendement de la Constitution du pays, notamment celui qui porte sur la liberté de parole : non seulement le plaignant doit-il démontrer que la déclaration émise à son sujet nuit à son estime, il doit aussi prouver qu’elle est fausse.
Depuis l’année 2000, on constate la judiciarisation grandissante de l’art et de la littérature [1]. Assignés de plus en plus souvent en diffamation, les auteurs des œuvres et des ouvrages controversés font face à une « logique de procès [2] » inexorable. Or, dans le cas de la création artistique ou littéraire d’ouvrages issus de l’imagination, l’idée même de la présentation d’un fait, c’est-à-dire d’un événement ou d’un phénomène qui fait partie du domaine du réel, est sujette à débat. Emprunté au latin diffamatio – qui signifie « divulguer, répandre » – et dans la famille du verbe transitif diffamer – qui vient du latin diffamare, de fama« renommée » –, le nom féminin diffamation présente d’emblée comme coupable l’auteur d’une œuvre dite diffamatoire, d’une œuvre que l’on croit produite en toute mauvaise foi. Être accusé de diffamation, c’est avoir transgressé la frontière entre la vérité et la fiction en produisant un ouvrage qui touche de trop près à la réalité ou qui reflète avec trop de clarté ou de façon erronée les lieux et les événements de la vie des autres. En art visuels, la question se complique davantage : peut-on porter atteinte à l’honneur d’une personne au moyen d’une peinture, d’une photographie ? C’est ce qu’affirme David Rieff, le fils de Susan Sontag, dans son livre Swimming in a Sea of Death (2008) : les photographies de sa mère agonisante et morte exposées dans le cadre de l’exposition « Annie Leibowitz : A Photographer’s Life, 1990-2005 » au National Portrait Gallery ne sont, pour lui, que des « images carnavalesques de la mort d’une célébrité [3] ».
Personnelles, intimes, compliquées et souvent hautement médiatisées, les œuvres dites diffamatoires n’entrent pas facilement dans le cadre des analyses sociohistoriques de l’art et de la littérature. En portant à la connaissance du lectorat des idées contestées, elles relèvent de l’intrigue, font agir de façon spectaculaire des jeux de pouvoir et nourrissent le désir universel de voir et de savoir ce qui aurait peut-être dû être passé sous silence. Ce faisant, elles semblent appartenir au domaine du divertissement plutôt qu’à celui des idées. Il suffit, pour en être convaincu, de penser à Merci pour ce moment (2014), le récit autobiographique de Valérie Treirweiler publié en fanfare seulement neuf mois après sa séparation d’avec le président français François Hollande ou encore à Beyond Reason (1979), les mémoires controversés de Margaret Trudeau. D’ailleurs, comme l’a écrit Martial Raysse dans un article condamnant Sophie Calle pour avoir élaboré une œuvre inspirée de leur rupture amoureuse, la diffamation peut même présenter un danger redoutable pour le futur de l’art contemporain. Raysse se lamente de la médiatisation de l’art et exprime un mécontentement général provoqué par le fait que les institutions culturelles investissent dans une forme artistique populaire, facile et, à son avis, rentable. « La liberté en soi de l’artiste s’arrête quand commence celle de l’autre. Une chose est de créer, une autre de s’autoriser à diffamer sous le couvert de la création. Quel que soit le niveau des circonstances, et sous quelque prétexte qui soit, il ne faut pas laisser s’installer de telles pratiques [4] » nous prévient-il.
Tout de même, c’est précisément à cause du fait qu’elles mettent à l’épreuve les hiérarchies de valeurs des institutions culturelles que les œuvres dites diffamatoires nous défient de les étudier sérieusement. Elles soulèvent aussi la question de l’éthique de la création artistique, font naître des discours sur la liberté d’expression, cernent les limites de la liberté de création au regard de la loi et témoignent de la véritable force de l’art et de la littérature dans le réel. Dans certains cas – dont celui de Trierweiler, l’auteure d’un ouvrage qui est « une riposte personnelle sans précédent dans l’histoire de la Ve République [5] » selon Matthieu Écoiffier, journaliste pour Libération – leur valeur historique est incontestable. Sans aucun doute, les œuvres dites diffamatoires posent problème, autant pour les personnes qui s’y reconnaissent contre leur gré que pour les critiques censés évaluer leur mérite artistique ou littéraire et pour les juges dont la tâche est de démêler les intentions des auteurs des effets que ces ouvrages ont apparemment produits sur leurs dites victimes.
Comment se situer en tant que chercheurs, critiques et commentateurs face à des œuvres artistiques ou littéraires qui ont valu à leurs auteurs la condamnation juridique ? qui ont ostensiblement été publiées ou exposées pour faire accroître la visibilité d’une personne au détriment de la réputation d’une autre ? dont la qualité artistique ou littéraire est souvent éclipsée par la vérité qu’elles proclament, les secrets qu’elles révèlent et les médisances qu’elles débitent ? Méritent-elles l’inclusion dans les canons artistiques et littéraires ? Si non, pourquoi pas ? Que nous révèle leur statut d’objet d’étude contesté sur les lettres et l’histoire de l’art ? Si oui, partagent-elles des traits stylistiques, des stratégies rhétoriques, des qualités esthétiques ? Pourrions-nous théoriser une esthétique ou une éthique de la diffamation ? Quelle serait sa spécificité ? Qui en seront les artistes phares ? Quels en seraient les précédents historiques ?
Axes de réflexions possibles
1. Les nouveaux experts : l’art, la littérature et la loi. Les œuvres dites diffamatoires font entrer le discours juridique dans le domaine des lettres et dans celui des arts visuels. Or, comme l’explique Agnès Tricoire, « un jugement de droit qui interprète une œuvre se trompe par définition, puisqu’il rend un ce qui devrait rester multiple. Il transforme un jugement de goût, qui devrait se proposer à l’universel, en jugement qui impose » [6]. Comment gérer cette intrusion, une intrusion qui semble faire prévaloir les considérations juridiques sur l’autonomie de l’art ? Quelle place peut-on faire en tant que chercheurs, critiques et commentateurs aux nouveaux experts sur ce qui est considéré comme permissible en littérature et dans les arts, à savoir les juristes et les juges ? Comment assurer aux écrivains et aux artistes la liberté de créer tout en protégeant les droits des autres ? Le fait d’avoir vécu une chose, donne-t-il « le droit imprescriptible de l’écrire [7] » comme le soutient Annie Ernaux dans L’événement (2000) ? Comment rendre compte de l’autocensure ? Faut-il attendre qu’un verdict soit prononcé pour parler de diffamation ?
2. La diffamation et les hiérarchies de pouvoir. Les cas de diffamation exposent les hiérarchies et les structures sociales qui organisent la société dans laquelle ils sont étudiés, débattus et tranchés. Celui de Marcela Iacub révèle le sexisme inhérent à la loi : l’écrivaine a été forcée par ordonnance juridique d’insérer un encart proclamant l’atteinte à la vie privée de Dominique Strauss-Kahn dans Belle et Bête (2013) alors qu’elle ne l’y nomme nulle part. Les hauts fonctionnaires puissants, toutefois, ne sont pas les seules victimes de diffamation en littérature et en art. La diffamation peut également être dirigée – et elle l’est souvent – contre ceux pour qui le droit de réponse n’est pas garanti. Le cas récent d’Édouard Louis est caractéristique de la façon dont s’articulent les rapports de sexe, d’ethnicité, de classe sociale et d’orientation sexuelle en France : l’écrivain a été accusé d’atteinte à la présomption d’innocence et à la vie privée par « Reda », le Kabyle qu’il décrit comme son violeur dans Histoire de la violence (2016). L’histoire racontée dans le texte est conforme à la déposition faite par Louis à la police suite au drame survenu en 2012, mais ledit Reda n’a été arrêté qu’après la parution de l’œuvre – à savoir, quatre ans plus tard –, la reconnaissance de la violence commise à l’endroit de Louis étant selon toute apparence conditionnelle à son dévoilement public par l’écrivain. Comment rester sensible aux hiérarchies de pouvoir qui se jouent très clairement ainsi ?
3. La diffamation, la critique et la célébrité. Par l’échange du bien que Nathalie Heinich nomme le « capital de visibilité », la figure du créateur est devenue plus médiatisée, plus publique et plus influente que jamais. Les cas de diffamation ne font qu’accroître la visibilité de l’artiste ou de l’écrivain accusé. Qu’en est-il du critique qui décide de se mêler aux affaires portées en justice en donnant son avis de spécialiste à leur sujet ? Profite-t-il de la notoriété de l’écrivain ou de l’artiste étudié ou sort-il décrédibilisé en tant que chercheur pour avoir traité d’un sujet pensé trop intime, trop courant, trop populaire ? Suffit-il d’adopter une sorte d’éthique neutre de chercheur pour éviter d’être stigmatisé par les intrigues qu’on choisit d’analyser ? Que dire du critique, du chercheur ou du commentateur diffamateur ?
Avec la participation d’Elisabeth Ladenson, professeure de littérature française et comparée (Columbia University), auteure de Dirt for Art’s Sake : Books on Trial from Madame Bovary to Lolita (2007) et d’Agnès Tricoire, avocate à la cour de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, auteure du Petit traité de la liberté de création (2011).
Les propositions de communication (300-500 mots), accompagnées d’un bref C.V. précisant l’affiliation institutionnelle du chercheur, devront être adressées aux organisateurs avant le 1er décembre 2016 aux coordonnées suivantes : diffamation.artlit@gmail.com.
Les communications en anglais sont acceptées.
Diffamation : art et littérature de l’infamie
22 et 23 mai 2017, Université du Québec à Montréal
Date limite : 15 octobre 2016
Organisateurs : Ania Wroblewski (UQAM) et Vincent Lavoie (UQAM)
Colloque international placé sous l’égide du programme de recherche interdisciplinaire RADICAL (Repères pour une articulation des dimensions culturelles, artistiques et littéraires de l’imaginaire contemporain), rattaché à Figura, centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (www.figura.uqam.ca)
Comité scientifique
Ania Wroblewski, Département d’histoire de l’art, UQAM
Vincent Lavoie, Département d’histoire de l’art, UQAM
Mathilde Barraband, Département de lettres et communication sociale, UQTR
Samuel Archibald, Département d’études littéraires, UQAM
Alain Farah, Département de langue et de littérature française, Université McGill
[1] Agnès Tricoire, Petit traité de la liberté de création, Paris, Éditions La Découverte, 2011, p. 8.
[2] Karin Schwerdtner, « Au (beau) risque du “retour”. Entretien avec Camille Laurens », Essays in French Literature and Culture, 51 (novembre 2014), p. 135.
[3] David Rieff, Swimming in a Sea of Death : A Son’s Memoir, New York, Simon & Schuster, 2008, p. 150. Nous traduisons « carnival images of celebrity death ».
[4] Martial Raysse, « Secret de Polichinelle », Le Monde, (18 décembre 2003), p. 16.
[5] Matthieu Écoiffier, « Valérie Trierwieler sans merci », Libération, (3 septembre 2014).
[6] Agnès Tricoire, « Les dangers du relativisme pour la liberté de l’art », Sur l’interdit, sous la direction de Pierre-Yves Soucy, Bruxelles, Lettre volée, coll. « Étrangère », 2009, p. 142-143.
[7] Annie Ernaux, L’événement, Paris, Éditions Gallimard, 2000, p. 58.

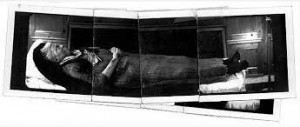
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.